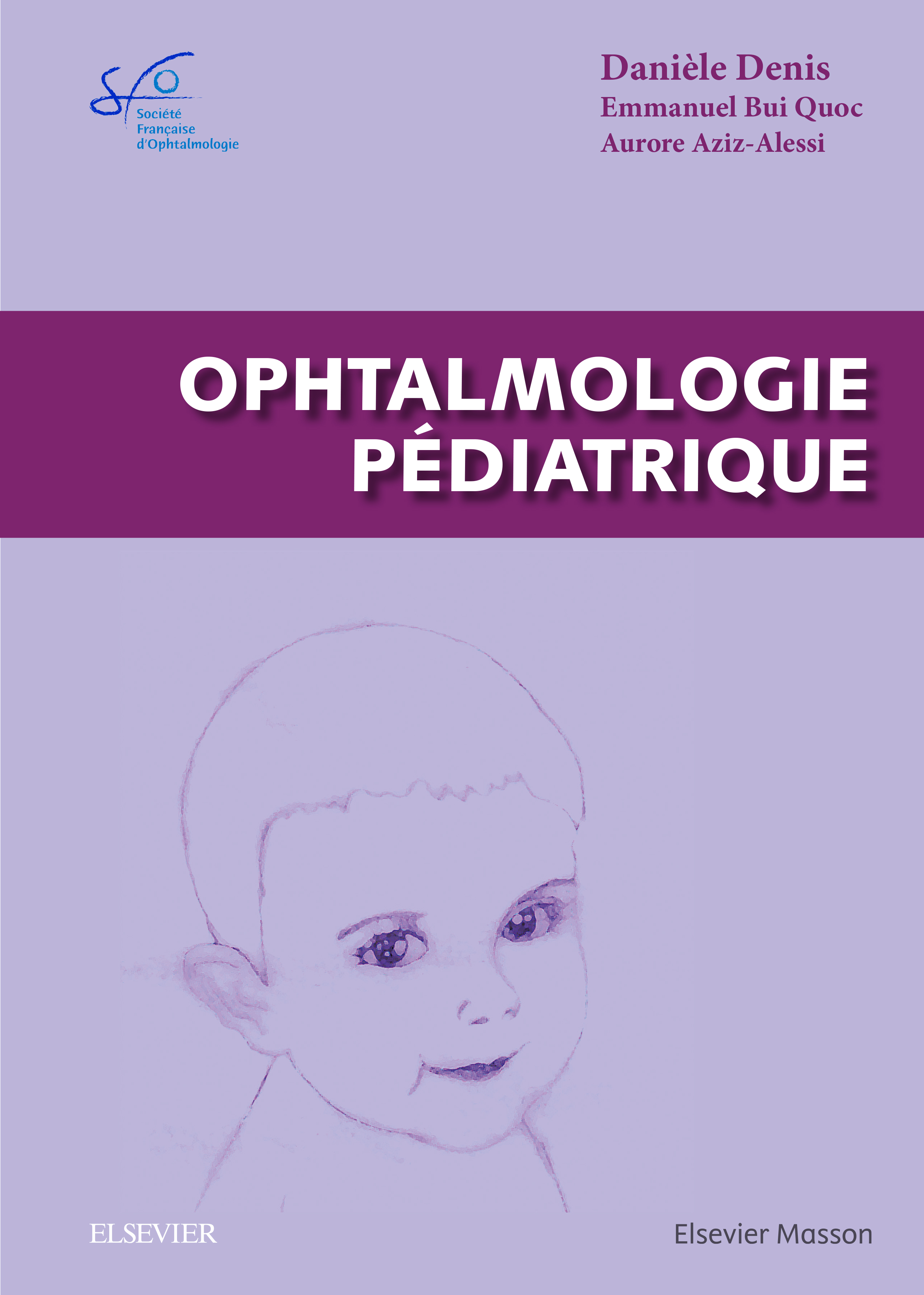
Rapports présentés à la Société Française d’Ophtalmologie :
OEdèmes maculaires, par C. Creuzot-Garcher, P. Massin et collaborateurs, 2016, 635 pages.
Chirurgie du regard, par O. Galatoire, 2016, 256 pages.
Surface oculaire, par P.-J. Pisella, C. Baudouin, T. Hoang-Xuan et collaborateurs, 2015, 677 pages.
Glaucome primitif à angle ouvert, par J.-P. Renard, E. Sellem et collaborateurs, 2014, 747 pages.
Strabisme, par A. Péchereau et collaborateurs, 2013, 544 pages.
Presbytie, par B. Cochener et collaborateurs, 2012, 456 pages.
Décollements de rétine, par G. Caputo et collaborateurs, 2011, 560 pages
Les uvéites, par A. P. Brézin et collaborateurs, 2010, 760 pages.
Les lentilles de contact, par F. Malet et collaborateurs, 2009, 1 088 pages.
Pathologies vasculaires oculaires, par C. Pournaras et collaborateurs, 2008, 848 pages.
Les DMLAs, par G. Soubrane et collaborateurs, 2007, 672 pages.
Les voies lacrymales, par A. Ducasse et collaborateurs, 2006, 640 pages.
OEil et Génétique, par J.-L Dufier, J. Kaplan et collaborateurs, 2005, 640 pages.
Neuro-ophtalmologie, par A.B. Safran et collaborateurs, 2004, 848 pages.
Pathologie du vitré, par G. Brasseur et collaborateurs, 2003, 528 pages.
Tumeurs intraoculaires, par L. Zografos et collaborateurs, 2002, 740 pages.
Chirurgie réfractive, par J.-J. Saragoussi et collaborateurs, 2001, 826 pages.
OEil et virus, par H. Offret et collaborateurs, 2000, 584 pages.
Exploration de la fonction visuelle, par J.-F. Risse et collaborateurs, 1999, 800 pages.
Pathologie orbito-palpébrale, par J.-P. Adenis, S. Morax et collaborateurs, 1998, 848 pages.
OEil et pathologie générale, par J. Flament, D. Storck et collaborateurs, 1997, 848 pages.
L’imagerie en ophtalmologie, par E.-A. Cabanis, H. Bourgeois, M.-T. Iba-Zizen et collaborateurs, 1996, 784 pages.
La rétinopathie diabétique, par J.-D. Grange et collaborateurs, 1995, 648 pages.
Rapport 2017
OPHTALMOLOGIE PÉDIATRIQUE
par
Danièle Denis
Emmanuel Bui Quoc
Aurore Aziz-Alessi
avec la collaboration de
Pierre Wary,
Sabine Defoort-Dhellemmes, Pierre Gastaud, Guylène Le Meur, Pierre Lebranchu, Christine Levy-Gabriel, Isabelle Meunier, Solange Milazzo, Christophe Orssaud, Alain Péchereau, Matthieu Robert, Claude Speeg-Schatz, Émilie Zanin
et de
Karine Angioi-Duprez, Amandine Barjol, Corinne Beaube-Bok, Corinne Benso-Layoun, Marie Beylerian, Bahram Bodaghi, Carole Burillon, Marie Callet, Patrick Calvas, Brigitte Chabrol, Christine Costet, Chloé Couret, Vincent Daien, Hélène Dalens, Anne de Saint-Martin, Nathalie Dégardin, Laurence Desjardins, Isabelle Drumare-Bouvet, Pascal Dureau, Heather Etchevers, Bruno Fayet, Olivier Galatoire, Audrey Gallucci, Nicole Gambarelli, Nadine Girard, Michel Habib, Christian Hamel, Louis Hoffart, Pierre-François Kaeser, Laurent Kodjikian, Béatrice Le Bail, Livia Lumbroso-Le Rouic, Pascale Massin, Frédéric Matonti, Florence Metge-Galatoire, Bruno Mortemousque, Marc Muraine, Élisabeth N’Guyen, Grégoire Pech-Gourg, Pierre-Yves Robert, Vincent Soler, Dominique Thouvenin, Jean-Michel Triglia, Liza Vera, Xavier Zanlonghi
et de
Sophie Ajzenfisz, Franck Amouyal, Nicolas André, François Audren, Maxence Badguerahanian, Coline Barraud, Danièle Basset, William Basson, Valentine Bautrant, Daniel Benaim, Jérémy Benichou, Catherine Blanchet, Patricia Blanchet, Béatrice Bocquet, Odile Boespflug-Tanguy, Mathilde Boiché, Alexandra Bolufer, Emmanuelle Bosdure, Ikram Bouacha, Olivier Bourdon, Romain Bouvier, Dominique Bremond-Gignac, Hervé Brunel, Sophie Bryselbout, Christine Bulteau, Benjamin Butet, Vincent Canel, Georges Caputo, Ania Carsin, Maéva Chardavoine, Nicolas Chassaing, François Cheynet, Monique Cordonnier, Sophie Creuzet, Adil Darugar, Claude d’Ercole, Véronique Desio, Claire-Marie Dhaenens, Rémi Dumont, Olivier Durbec, Marie-Andrée Espinasse-Berrod, Alexandre Fabre, Erwan Fauviaux, Éric Gabison, Pierre Gascon, Marie-Noëlle Georges, Léa Gérard, Domitille Gras, Ghita Guedira, Héléna Guigue, Damien Guindolet, Clémentine Guis, Laurent Guyot, Marie-Amélie Heng, Gaëlle Ho Wang Yin, Charlotte Jaloux, Benjamin Jany, Anne-Laure Jurquet, Oman Khawaja, Marie-Christine Koeppel, Annie Lacroux, Céline Landré, David Lassalle, Phuc LeHoang, Natanael Levy, Orlane Madar, Emmanuelle Maes, François Malecaze, Florence Malet, Stéphanie Mallet, Caroline Marks, Émeline Marquand, Cécilia Mazzeo, Philippe Minodier, Nicolas Moineau, Claire Oudin, Caroline Ovaert, Marie Perez, Romain Praud, Véronique Promelle, Sonia Prot-Labarthe, Bernard Puech, Emmanuel Racy, Nesrine Rahmania, Anne-Laure Remond, Rachel Reynaud, Caroline Rousset-Rouvière, Anne-Françoise Roux, Magali Sampo, Arnaud Sauer, Didier Scavarda, Caroline Seghir, Vasily Smirnov, Natacha Stolowy, Nabil Taright, Gwenaelle Touvron, Laurence Vaivre-Douret, Marine Viellard, Johannes Ziegler
Collaborateurs
Sophie Bertrand, Frédéric Collet, Muriel Derbez, Michèle Duflanc, Monique Marongiu, Gilles Renard
Préface de
David Taylor
Illustrations de la couverture
Sophie Martinet
Illustrations de Cyrille Martinet
martinet@numericable.com
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).
© Société Française d’Ophtalmologie, 2015
ISBN : 978-2-294-75022-9
E-ISBN : 978-2-294-75445-6
Elsevier Masson SAS, 65, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex

Danièle Denis
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital Nord, AMU AP-HM, Marseille

Aurore Aziz-Alessi
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

Emmanuel Bui Quoc
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille


Karine Angioi-Duprez
Ophtalmologiste, PU-PH, Nancy

Amandine Barjol
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris

Marie Beylerian
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille

Bahram Bodaghi
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris

Carole Burillon
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital Édouard Herriot, Lyon

Marie Callet
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille

Patrick Calvas
Généticien, PU-PH, CHU Toulouse

Brigitte Chabrol
Neuropédiatre, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille

Christine Costet
Ophtalmologiste, Nice

Chloé Couret
Ophtalmologiste, PH, CHU Nantes

Vincent Daien
Ophtalmologiste, PHU, CHU Montpellier

Sabine Defoort-Dhellemmes
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Salengro, CHU de Lille

Nathalie Dégardin
Ophtalmologiste, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille

Laurence Desjardins
Ophtalmologiste, PH, Institut Curie, Paris

Isabelle Drumare-Bouvet
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Salengro, CHU Lille

Pascal Dureau
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris

Heather Etchevers
Généticienne, INSERM, Marseille

Bruno Fayet
Ophtalmologiste, PH, Hôtel Dieu, AP-HP, Paris

Olivier Galatoire
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris

Nicole Gambarelli
Ophtalmologiste, Marseille

Pierre Gastaud
Ophtalmologiste, PU-PH honoraire, Nice

Nadine Girard
Neuroradiologue pédiatre, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU, UMR CNRS, AP-HM, Marseille

Michel Habib
Psychiatre, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille

Christian Hamel
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU Gui de Chauliac, Montpellier

Louis Hoffart
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille

Laurent Kodjikian
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU de Lyon

Béatrice Le Bail
Ophtalmologiste, Évry

Guylène Le Meur
Ophtalmologiste, MCU-PH, CHU de Nantes

Pierre Lebranchu
Ophtalmologiste, PHU, CHU de Nantes

Christine Levy-Gabriel
Ophtalmologiste, PH, Institut Curie, Paris

Livia Lumbroso-Le Rouic
Ophtalmologiste, PH, Institut Curie, Paris

Pascale Massin
Ophtalmologiste, PU-PH, Paris

Frédéric Matonti
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital Nord, AMU AP-HM, Marseille

Florence Metge-Galatoire
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris

Isabelle Meunier
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier

Solange Milazzo
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU d’Amiens

Bruno Mortemousque
Ophtalmologiste, PU-PH, Bordeaux

Marc Muraine
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU de Rouen

Élisabeth N’Guyen
Ophtalmologiste, Nice

Christophe Orssaud
Ophtalmologiste, PH, Hôpital européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

Grégoire Pech-Gourg
Neurochirurgien pédiatrique, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille

Alain Péchereau
Ophtalmologiste, PU-PH honoraire, CHU de Nantes

Matthieu Robert
Ophtalmologiste, PHU, Hôpital Necker, AP-HP, Paris

Pierre-Yves Robert
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU de Limoges

Vincent Soler
Ophtalmologiste, MCU-PH, Toulouse

Claude Speeg-Schatz
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU de Strasbourg

Dominique Thouvenin
Ophtalmologiste, Toulouse

Jean-Michel Triglia
Oto-rhino-laryngologiste, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille

Liza Vera
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

Pierre Wary
Ophtalmopédiatre, praticien attaché, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille

Émilie Zanin
Ophtalmologiste, PH, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille

Xavier Zanlonghi
Ophtalmologiste, Nantes
Sophie Ajzenfisz
Pédiatre, PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Franck Amouyal
Ophtalmologiste, Tel Aviv, Israël
Nicolas André
Oncopédiatre, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
François Audren
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris
Maxence Badguerahanian
Interne en ophtalmologie, Amiens
Coline Barraud
Neuropédiatre, CCA, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Danièle Basset
Technicienne hospitalière, Hôpital Salengro, CHU de Lille
William Basson
Interne en ophtalmologie, Amiens
Valentine Bautrant
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Corinne Beaube-Bok
Ophtalmologiste, Fribourg, Suisse
Daniel Benaim
Ophtalmologiste, CHU de Rouen
Jérémy Benichou
Interne en ophtalmologie, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Corinne Benso-Layoun
Ophtalmologiste, Gardanne
Catherine Blanchet
ORL, PH, CHU de Montpellier
Patricia Blanchet
Généticienne, PH, CHU de Montpellier
Béatrice Bocquet
Ingénieur assistante recherche en génétique, CHU de Montpellier
Odile Boespflug-Tanguy
Neuropédiatre, PU-PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Mathilde Boiché
Interne en ophtalmologie, Amiens
Alexandra Bolufer
Orthoptiste, Marseille
Emmanuelle Bosdure
Infectiologue pédiatre, PH, AP-HM, Marseille
Ikram Bouacha
Ophtalmologiste, Hôpital Salengro, CHU de Lille
Olivier Bourdon
Pharmacien, PU-PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Romain Bouvier
Interne en ophtalmologie, CHU d’Amiens
Dominique Bremond-Gignac
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital Necker, AP-HP, Paris
Hervé Brunel
Neuro-radiologue pédiatrique, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille
Sophie Bryselbout
Interne en ophtalmologie, CHU d’Amiens
Christine Bulteau
Neuropédiatre, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Benjamin Butet
Ophtalmologiste, CCA, CHU de Nice
Vincent Canel
Technicien hospitalier, Hôpital Salengro, CHU de Lille
Georges Caputo
Ophtalmologiste, Fondation Rothschild, Paris
Ania Carsin
Pneumologue pédiatre, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Maéva Chardavoine
Interne en ophtalmologie, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Nicolas Chassaing
Généticien, MCU-PH, CHU de Toulouse
François Cheynet
Chirurgien maxillo-facial, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Monique Cordonnier
Ophtalmologiste, professeur, Hôpital Érasme, Bruxelles, Belgique
Sophie Creuzet
Chercheur en neurosciences, CNRS, Gif-sur-Yvette
Hélène Dalens
Ophtalmologiste, PH, CHU Clermont-Ferrand
Adil Darugar
Ophtalmologiste, Paris
Claude d’Ercole
Gynécologue-obstétricien, PU-PH, Hôpital Nord, AMU AP-HM, Marseille
Anne de Saint-Martin
Neurologue pédiatrique, CHU Strasbourg
Véronique Desio
Anesthésiste, Nice
Claire-Marie Dhaenens
Biologiste, MCU-PH, CHU de Lille
Rémi Dumont
Interne en pharmacie, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Olivier Durbec
Anesthésiste, PH, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Marie-Andrée Espinasse-Berrod
Ophtalmologiste, Paris
Alexandre Fabre
Gastropédiatre, Hôpital d’Enfants, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Erwan Fauviaux
Interne en ophtalmologie, Amiens
Éric Gabison
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital Bichat, AP-HP, Paris
Audrey Gallucci
Chirurgien maxillo-facial, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Pierre Gascon
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Marie-Noëlle Georges
Ophtalmologiste, Nantes
Léa Gérard
Orthoptiste Nantes
Domitille Gras
Neuropédiatre, PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Ghita Guedira
Interne en ophtalmologie, Amiens
Héléna Guigue
Ophtalmologiste, CCA, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Damien Guindolet
Interne en ophtalmologie, Paris
Clémentine Guis
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Laurent Guyot
Chirurgien maxillo-facial, PU-PH, Hôpital Nord, AMU AP-HM, Marseille
Marie-Amélie Heng
Oncopédiatre, Hôpital d’enfants, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Gaëlle Ho Wang Yin
Interne en ophtalmologie, Hôpital Timone, AP-HM, Marseille
Charlotte Jaloux
Chirurgien plastique pédiatre, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Benjamin Jany
Ophtalmologiste, Amiens
Anne-Laure Jurquet
Rhumatopédiatre, PH, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Pierre-François Kaeser
Ophtalmologiste, maître d’enseignement et de recherche clinique, Hôpital Jules Gonin, Lausanne, Suisse
Oman Khawaja
Interne en ophtalmologie, CHU d’Amiens
Marie-Christine Koeppel
Dermatologue, PH, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Annie Lacroux
Assistante de recherche clinique, CHU de Montpellier
Céline Landré
Ophtalmologiste, CCA, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
David Lassalle
Orthoptiste, CHU Nantes
Phuc LeHoang
Ophtalmologiste, PU-PH, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
Natanael Levy
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Orlane Madar
Interne en ophtalmologie, CHU Amiens
Emmanuelle Maes
Psychologue, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
François Malecaze
Ophtalmologiste, PU-PH, Toulouse
Florence Malet
Ophtalmologiste, Bordeaux
Stéphanie Mallet
Dermatologue pédiatre, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Caroline Marks
Ophtalmologiste, Hôpital Salengro, CHU de Lille
Émeline Marquand
Endocrinopédiatre, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Cécilia Mazzeo
Anesthésiste, CCA, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Philippe Minodier
Pédiatre urgentiste infantile, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille
Nicolas Moineau
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Claire Oudin
Hématologue pédiatre, MCU-PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Caroline Ovaert
Cardiologue pédiatre, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille
Marie Perez
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Romain Praud
Opticien, Nantes
Véronique Promelle
Ophtalmologiste, CCA, CHU d’Amiens
Sonia Prot-Labarthe
Pharmacien, PH, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Bernard Puech
Ophtalmologiste, Hôpital Salengro, CHU de Lille
Emmanuel Racy
Oto-rhino-laryngologiste, Paris
Nesrine Rahmania
Interne en ophtalmologie, Amiens
Anne-Laure Remond
Ophtalmologiste, Paris
Rachel Reynaud
Endocrinopédiatre, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille
Matthieu Robert
Ophtalmologiste, PHU, Hôpital Necker, AP-HP, Paris
Caroline Rousset-Rouvière
Néphropédiatre, MCU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille
Anne-Françoise Roux
Généticienne, PH, CHU de Montpellier
Magali Sampo
Ophtalmologiste, CCA, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Arnaud Sauer
Ophtalmologiste, PU-PH, CHU de Strasbourg
Didier Scavarda
Neurochirurgien pédiatrique, PU-PH, Hôpital de la Timone, AMU AP-HM, Marseille
Caroline Seghir
Ophtalmologiste, Paris
Vasily Smirnov
Interne en ophtalmologie, Lille
Natacha Stolowy
Interne en ophtalmologie, AP-HM, Marseille
Nabil Taright
Ophtalmologiste, CCA, CHU d’Amiens
Gwenaelle Touvron
Ophtalmologiste, Marseille
Laurence Vaivre-Douret
Psychologue, PU, Paris
Marine Viellard
Pédopsychiatre, PH, Hôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
Johannes Ziegler
Chercheur, CNRS, Aix-Marseille
Sophie Bertrand
Orthoptiste, Hôpital Nord, Marseille
Frédéric Collet
Cardiologue, Marseille
Muriel Derbez
Ophtalmologiste, Gardanne
Michèle Duflanc
Ophtalmologiste, Toulon
Monique Marongiu
Secrétaire médicale, Hôpital Nord, Marseille
Gilles Renard
Directeur administratif, Société Française d’Ophtalmologie, Paris

David Taylor
Professeur émérite,
Institute of Child Health,
Londres
C’est un grand privilège d’être invité à rédiger une préface à ce très impressionnant Rapport Ophtalmologie pédiatrique de la Société Française d’Ophtalmologie, organisé et écrit par le noyau actif au sein de l’ophtalmologie pédiatrique française sous la direction du Pr Danièle Denis. En mettant l’accent sur les problèmes les plus graves qui peuvent bouleverser la vie des enfants concernés, ce livre reflète réellement la situation de la profession d’ophtalmologie pédiatrique de nos jours. Cette publication est très intéressante aussi, car une grande partie du texte est axée sur le symptôme ou l’état clinique, faisant de ce travail un livre très pratique, accessible et lisible. Une section inédite traite de comment nous, les ophtalmopédiatres, interagissons avec nos collègues pédiatres d’autres spécialités. Surtout, dès sa parution, ce volume sera la publication francophone la plus importante sur l’ophtalmologie pédiatrique de notre époque et tout aussi valable que n’importe quel autre paru dans d’autres langues.
Plusieurs fois dans une vie professionnelle, il est bon de faire le point sur les succès accomplis, mais aussi sur les difficultés et les échecs auxquels nous faisons face, afin de progresser et protéger la vue des enfants que nous soignons.
Je vais tenter de faire le bilan. Cependant, ce que j’exprime dans la préface de cette publication très prometteuse est mon propre point de vue ; je n’expose donc pas des faits mais une opinion personnelle.
Les pionniers de différents domaines en médecine sont nombreux et d’horizons différents. Dans la plupart des grandes civilisations, chacune à un moment donné de l’histoire a pu être un précurseur dans le domaine de l’ophtalmologie générale, et maintenant que la sur-spécialisation devient une voie à suivre, c’est au sein de chacune de ces sur-spécialités que les avancées ont pu naître dans différents pays.
Les enfants ont souvent des problèmes oculaires et ils ont besoin d’une quantité de soins professionnels plus importante que la population en général : cela doit être le cas depuis des temps immémoriaux.
Au cours des xviiie et xixe siècles, les archives attestent que plusieurs médecins spécialistes traitaient des patients pour des maladies oculaires. Ces patients étaient souvent des enfants envoyés par un généraliste et ils étaient nombreux. William Mackenzie, de Glasgow, en Écosse, dans son Practical Treatise on the Diseases of the Eye [1] de 1830, a consacré une grande partie de son livre aux traitements de la cataracte chez l’enfant. Il traite des questions telles que l’opportunité ou pas d’une chirurgie bilatérale simultanée, la gestion préopératoire (y compris la question de la meilleure saison pour opérer) et la question cruciale de l’âge de la chirurgie. « Dans les cas de cataracte congénitale, l’opération devrait-elle être retardée jusqu’à ce que le patient ait atteint un âge suffisant pour lui permettre de donner son assentiment, ou doit-elle être pratiquée pendant la petite enfance ? » ( « In cases of congenital cataract, ought the operation be delayed ’till the patient has attained an age sufficient to enable him to give his assent, or ought it to be practised during infancy ? » ) Il répond à sa propre question : « La réponse est décidément d’opérer pendant la petite enfance » ( « The answer decidedly is to operate in infancy » ). Il poursuit en notant qu’une meilleure vision est ainsi obtenue.
Partout dans le monde, les ophtalmologistes convenaient que, tandis qu’il valait mieux opérer les cataractes bilatérales de bonne heure (de bonne heure pour l’époque), une cataracte congénitale unilatérale présentait un obstacle insurmontable. Prudhommeaux [2], en 1962, a opéré 65 cas, dont 17 formes unilatérales : dans tous ces 17 cas, le résultat était au mieux une perception de la lumière. « Il faut alors poser la question : pourquoi doit-on opérer les cataractes congénitales unilatérales ? » François [3], le célèbre ophtalmologiste belge, a dit : « Tout le monde connaît l’inutilité d’opérer la cataracte congénitale unilatérale » .
Heureusement, il y a toujours ceux qui défient les idées reçues de sorte que, dans les années 1970, certains médecins lecteurs de publications scientifiques spécifiques se sont rendu compte qu’il y avait sûrement des raisons pour pratiquer la chirurgie précoce de la cataracte congénitale, ainsi que la correction optique et le traitement de l’amblyopie par une occlusion. Mais à part quelques cas où les résultats fonctionnels étaient satisfaisants, il n’y avait aucune preuve d’efficacité. Finalement, Beller et al. [4] ont prouvé non seulement que la chirurgie précoce de la cataracte congénitale donnait un meilleur résultat, mais aussi que les mauvais résultats constatés auparavant étaient souvent dus à une amblyopie non ou mal traitée, et non à un mauvais développement ou à des maladies associées.
Il se peut que cette constatation dans l’exemple de la cataracte congénitale n’ait pas beaucoup modifié la prévalence de la déficience visuelle qui peut également bien sûr être la conséquence de très nombreuses pathologies, mais elle a montré clairement comment l’application de la recherche clinique couplée aux données de la recherche scientifique fondamentale, soigneusement menée, peut être utilisée pour améliorer notre pratique et obtenir de meilleurs résultats chez l’homme.
Au départ, l’une des principales influences sur la pratique clinique de l’ophtalmologie pédiatrique a été l’évolution de l’environnement où les enfants étaient soignés. Bien qu’il y ait des institutions prenant en charge les nourrissons abandonnés ( « foundlings » ) tels que l’Hôpital des Enfants Trouvés à Paris et le Foundling Hospital à Londres fondé par Thomas Coram, le premier hôpital pour enfants en tant que tel, l’Hôpital des Enfants-Malades, est fondé en 1802 à Paris ; d’autres en Europe et aux États-Unis ont rapidement suivi. La spécialisation dans les activités hospitalières a permis le progrès dans la prise en charge des enfants malades. Les motivations en sont multiples. Les médecins spécialistes « adulte » mais prenant en charge un enfant ont préféré que leurs patients soient traités par d’autres spécialistes ayant une expérience et une compétence avec les enfants ; ainsi naquit la pédiatrie. Cette attitude perdure aujourd’hui et, dans différentes spécialités, la sur-spécialisation pédiatrique s’est développée ; ce fut le cas de l’ophtalmologie pédiatrique.
L’anesthésie générale devenant plus accessible, plus efficace et plus sûre, le rôle des anesthésistes a évolué : aujourd’hui, les anesthésistes pédiatriques forment le plus grand groupe de spécialistes dans les hôpitaux d’enfants.
Le respect des règles d’antisepsie, suite aux travaux de Louis Pasteur au début du xixe siècle, se généralisant, les taux de réussite en chirurgie ont augmenté et les infections liées à la chirurgie ont régressé.
Le non-respect de ces règles est préjudiciable et c’est ce qui cause les infections nosocomiales.
Le strict respect des principes de base de l’hygiène, associé à de nouvelles interrogations sur les infections et leur mode de présentation et la façon de les éviter, les contrôler et les traiter, a permis de faire régresser ce taux des infections nosocomiales.
Les antibiotiques ont transformé le traitement des maladies infectieuses, mais le non-respect des indications de prescription a pu conduire à la résistance aux antibiotiques.
Le coût et les défis du développement de nouveaux antibiotiques ont contribué à créer un sérieux ralentissement dans la recherche de nouveaux antibiotiques. Un nouveau business model [5] pour leur développement, séparant le retour sur investissement du volume de leur vente, avec un investissement significatif dans la recherche de la part des gouvernements, par la mise en place d’incitations financières à toutes les étapes du cycle de production, pourrait améliorer la situation à moyen ou long terme.
L’ophtalmologie pédiatrique n’existait pas jusqu’au milieu du xxe siècle. À cette époque, de nombreux ophtalmologistes chefs de service ne voyaient pas l’intérêt d’une « sous » -spécialité distincte dans ce domaine (et souvent ils n’aimaient pas les patients enfant !).
De leur côté, les pédiatres préféraient orienter leurs patients vers des ophtalmologistes avec une expertise dans le traitement des enfants de tous âges, du nouveau-né à l’adolescent.
C’est dans ce contexte que se développa l’ophtalmologie pédiatrique en tant que sur-spécialité, à partir du milieu du xxe siècle.
Aux débuts de l’ophtalmologie pédiatrique, il était courant que l’ophtalmopédiatre traite ses patients pour toute une gamme de maladies – de l’amblyopie aux hallucinations visuelles… Il était normal que les ophtalmopédiatres, moi le premier, traitent (et opèrent) le strabisme, les troubles oculoplastiques, les pathologies orbitaires (souvent avec un neuro chirurgien), le glaucome, le rétinoblastome, les maladies lacrymales ainsi que la pathologie neuro-ophtalmologique et d’autres problématiques de l’ophtalmologie médicale et chirurgicale. Alors que la plupart des ophtalmopédiatres continuent de gérer un large éventail de cas, le nombre de super-spécialistes a augmenté au sein de la sur-spécialité de l’ophtalmologie pédiatrique. Et les pathologies rares ne sont traitées et opérées souvent que par une minorité.
Moi-même je me suis rendu compte que d’autres collègues avaient développé plus de compétences que moi dans certains domaines, ou que nous avions recruté un collègue avec des compétences plus appropriées que les miennes. C’est pourquoi j’ai renoncé, par ordre chronologique, à la chirurgie oculoplastique, au traitement du rétinoblastome et à la prise en charge du glaucome congénital. Je pense que c’est l’intérêt des enfants malades, mais une conséquence involontaire de cette sur-spécialisation dans la sur-spécialité elle-même pourrait bien être une sorte de « course aux armements » vers d’une part l’ultra-spécialisation de certains ophtalmologistes, et d’autre part un déclassement du rôle de certains ophtalmopédiatres vers un travail plus « routinier » , tel que le dépistage, la réfraction et la prise en charge générale des enfants.
Cette dégradation potentielle de carrière pourrait être évitée si des ophtalmopédiatres travaillaient dans un cadre où se rencontrent toutes les sur-spécialités, avec un accès direct aux collègues pour un dialogue permanent. L’ophtalmopédiatre pourrait lui-même apporter son expertise dans les services plus orientés dans une autre sur-spécialité, et profiter et apprendre des compétences d’un autre collègue en retour. Par exemple, la chirurgie de la cataracte adulte est différente de la chirurgie de la cataracte congénitale, mais il existe des synergies importantes, et l’ophtalmopédiatre opérant des cataractes congénitales progresse grâce aux connaissances de la chirurgie « adulte » .
L’ophtalmologie pédiatrique est un choix prisé de carrière, en partie parce que l’on travaille à l’hôpital, dans le cadre d’une équipe complète et cette spécialisation est perçue comme étant une partie intéressante de la formation. L’ophtalmologie est généralement une profession bien rémunérée par rapport à d’autres spécialités et comporte plusieurs possibilités de sur-spécialités dont un certain nombre d’ultra-spécialités, au choix. Le travail est techniquement et intellectuellement intéressant et le contact avec les patients et les parents est très enrichissant. Parfois la relation se prolonge pendant plusieurs décennies. Quelques ultra-spécialités au sein de l’ophtalmologie pédiatrique ont un attrait particulier pour certains ophtalmopédiatres. La strabologie reste la sur-spécialité par excellence au sein de l’ophtalmologie pédiatrique.
Le travail en ophtalmologie pédiatrique se fait en équipe, avec médecins et orthoptistes. De nouveaux protocoles se développent, en médecine comme en chirurgie, et la meilleure prise en charge des patients a conduit par exemple en strabologie à diminuer le nombre d’actes chirurgicaux.
Tout n’est pas parfait dans le domaine de l’ophtalmologie pédiatrique. Au sein de l’ophtalmologie, cette sur-spécialité est relativement peu rémunérée. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles ce choix a été moins prisé par les internes dans plusieurs pays au cours de ces dernières années ; récemment, aux États-Unis, seulement 47 % des postes d’interne en ophtalmologie pédiatrique et strabisme ont été pourvus. Ces internes ont préféré l’oculoplastie, la chirurgie réfractive et du segment antérieur comme sur-spécialités.
En ophtalmologie pédiatrique, l’activité de soins peut aussi se compléter d’une activité d’expertise ou juridique dans certaines structures des établissements de soins.
L’ophtalmologie pédiatrique concernant les plus jeunes des enfants, souvent de moins de 1 an, est un mélange fascinant de génétique, de prise en charge de pathologie malformative, de médecine métabolique et de neuro-ophtalmologie, avec un exercice dans un environnement multidisciplinaire. Il existe des protocoles et des traitements précis en ophtalmologie pédiatrique, par exemple pour la rétinopathie des prématurés, ce qui améliore la qualité de vie des patients au long terme. Cependant, pour beaucoup c’est un travail stressant. L’aspect juridique peut s’avérer compliqué ; les litiges, maintenant majoritairement résolus, peuvent être évités en suivant minutieusement la réglementation.
L’enseignement fait partie de nos obligations en ophtalmologie pédiatrique, afin de transmettre notre savoir et d’assurer la qualité et la pérennité des soins. L’enseignement est organisé à plusieurs niveaux. Il y a maintenant un certain nombre de sociétés d’ophtalmologie pédiatrique nationales ou internationales associés le plus souvent à la strabologie :
l’American Association of Paediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) outre-Atlantique ;
la British Isles Paediatric Ophthalmology and Strabismus Association (BIPOSA) – créée par des ophtalmopédiatres britanniques et irlandais ;
l’Association francophone de strabologie et d’ophtalmologie pédiatrique (AFSOP) active dans le monde francophone ;
l’European Paediatric Ophthalmology Society (EPOS) et l’European Strabismological Association (ESA), présents en Europe continentale.
Les congrès organisés à l’échelle mondiale, qui se tiennent habituellement dans des endroits exotiques ou touristiques, sont généralement très coûteux pour les internes qui en ont le plus besoin pendant leur formation initiale. Ces congrès difficiles à démocratiser et à gérer financièrement à mon avis ne sont pas forcément la meilleure façon de promouvoir l’ophtalmologie pédiatrique.
La forme la plus répandue de l’enseignement, et probablement la plus importante, se pratique auprès des patients, en consultation et dans les blocs opératoires à travers le monde, débutant à l’École de médecine et pour beaucoup se poursuivant tout au long de la vie. La plupart des médecins ont un souvenir très précis de talentueux enseignants qui les ont formés ou encadrés au cours de leur carrière. La formation didactique, par des clubs de lecture, des conférences ou des cours formels, joue un rôle aussi bien dans les études que pour la revalidation ou la re-certification et la formation continue. Cependant, c’est le contact essentiel avec les patients qui est primordial et ce que l’on apprend d’eux permet d’apprendre le métier de la médecine et d’éviter les erreurs. En ajoutant l’irremplaçable compréhension de ce qu’est la nature humaine, la formation d’un ophtalmopédiatre sera complète et réussie. Dans de nombreux pays, il est requis de se former à plein temps pendant au moins un an dans un service d’ophtalmologie pédiatrique afin de valider la formation avec accréditation et certification en ophtalmologie. L’apprentissage auprès de collègues d’autres pays, et d’autres sur-spécialités en ophtalmologie, est primordial pour un jeune médecin en formation.
Certaines formations initiales en ophtalmologie sont très organisées avec programme précis, tuteur officiel, participation à la recherche, évaluation régulière et nécessité de pratique exhaustive à la fois médicale et chirurgicale. Ce type de formation standardisée constitue une excellente forme d’apprentissage pour l’amélioration de la pratique médicale, mais elle n’est pas encore répandue. Par ailleurs, le médecin en formation peut parfois ressentir un effet adverse, car s’il vit cet enseignement « rigide » comme trop contraignant, il risque de perdre son élan de curiosité pour le processus d’apprentissage : un certain équilibre est donc nécessaire. Ceux qui doivent travailler beaucoup pour effectuer leurs études de manière individuelle et indépendante sont peut-être ceux qui apprennent le mieux et profitent le plus de leur formation. L’internat et la formation médicale évoluent au fil du temps, des contraintes pratiques, universitaires, financières, scientifiques, etc.
La plupart des études publiées par les ophtalmologistes traitent d’une question clinique et sont initiées en milieu hospitalier. En règle générale, un nouvel interne est orienté vers une étude de cas qui éclaire une question clinique. La plupart des internes acquièrent une méthodologie de recherche, soit à l’École de médecine ou pendant leurs études d’ophtalmologie, soit par contact avec des internes plus anciens ou des enseignants, soit par des séminaires orientés vers la recherche. Dans la plupart des pays, les possibilités de recherche les plus significatives sont liées à des choix très individuels. Nos éminents cliniciens-chercheurs d’aujourd’hui ont souvent commencé avec de « petites » études cliniques, qui se sont poursuivies et développées avec le temps. Les hasards et collaborations diverses ont pu faire progresser la question en jeu, amenant aux « découvertes » scientifiques et médicales de premier plan. L’application des découvertes génétiques d’aujourd’hui en thérapie effective pour le traitement de maladies rares et les politiques de santé publique sont de bon augure pour un meilleur avenir.
Alors que la plupart des recherches où peuvent être impliqués les ophtalmopédiatres sont poursuivies selon les contraintes de l’évolution de leur carrière clinique, il existe, dans plusieurs pays, des opportunités pour une carrière mixte scientifique et clinique. Ces possibilités ne sont pas nombreuses. L’exposition en début de carrière à un environnement universitaire, un chef de service inspirant, la participation à des travaux cliniques et scientifiques significatifs sont nécessaires à l’orientation vers une poursuite de cette voie mixte de clinique et de recherche, car très souvent l’ « attraction gravitationnelle » d’une carrière attire plutôt vers un travail clinique à temps plein.
Non seulement il est important d’impliquer les internes dans les études universitaires, mais idéalement il devrait exister des soutiens pour que les plus performants des jeunes médecins puissent accéder à des postes de qualité, mais bien sûr il existe une vive concurrence, car ces opportunités de qualité peuvent être rares et donc inévitablement insuffisantes en nombre pour satisfaire la demande.
Donc, quelle est la recette pour une bonne médecine et de bons ophtalmopédiatres ? Il n’y a pas, bien sûr, qu’une seule réponse, mais la nature, l’éducation et le hasard contribuent tous à la carrière de chaque ophtalmopédiatre qui réussit. Quelques pistes : être intelligent, avoir un entourage qui vous soutient, être sérieux et entreprenant dans ses études, commencer de bonne heure dans la vie à accumuler des connaissances et des compétences de toutes sortes pour soi et aussi utiles pour aider les patients à chaque étape de la vie. Il faudrait être systématiquement formé par des enseignants sympathiques qui inspirent, guident et démontrent que, dans notre métier, l’éthique, la morale et l’humanité de notre profession sont essentielles pour nous donner les outils, encore et encore, pour prolonger un dévouement qui perdurera toute la vie envers les enfants atteints de maladies des yeux.
Une condition préalable est essentielle : avoir accès à de bons matériaux d’étude, tels que ce Rapport, à une étape propice du processus d’apprentissage. Et, si la chance nous sourit, être au bon endroit au bon moment, avoir le talent nécessaire pour faire carrière, créer des amitiés et enrichir nos vies ainsi que celles de nos patients.
Mais, dans le fond, il est de la responsabilité de chacun de se former, de se renforcer, de s’améliorer pour éventuellement changer.
[1] Mackenzie W. Practical Treatise on the Diseases of the Eye. London : Longman, Rees, Orme & Green ; 1830. p. 594-7.
[2] Prudhommeaux MP. Le résultat obtenu après opération pour cataracte congénitale. Bull Soc Ophtalmol Fr 1962 ; 62 : 383-430.
[3] François J. Late results of congenital cataract surgery. J Pediatr Ophthalmol 1970 ; 7 : 139-45.
[4] Beller R, Hoyt CS, Marg E, Odom JV. Good visual function after neonatal surgery for congenital monocular cataracts. Am J Ophthalmol 1981 ; 91 : 559-65.
Consultez la version originale en anglais de cette préface en cliquant ici.
L’ophtalmologie pédiatrique est née au milieu du xxe siècle aux États-Unis. Le Dr Franck Costenbader en 1943 a été le premier ophtalmologiste à avoir une activité exclusivement pédiatrique. Mais c’est son premier élève M.M. Parks qui réunit dès les années 1960 les ophtalmopédiatres américains, et formalise en 1975 la création de l’Association américaine d’ophtalmologie pédiatrique (AAPO) devenant en 1977 l’Association américaine d’ophtalmologie pédiatrique et de strabologie (AAPOS) alliant d’emblée les forces de la strabologie et de l’ophtalmologie pédiatrique. En France dans la seconde partie du xxe siècle seront créées de façon indépendante l’Association française d’ophtalmo-pédiatrie (Pr Urvoy : 1975) et l’Association francaise de strabologie (Pr Bérard : 1984) ; cette dernière évoluera en Association francophone de strabologie et d’ophtalmologie pédiatrique en 2008 sous l’impulsion du Pr Alain Péchereau.
Si des Rapports de la Société Française d’Ophtalmologie ont déjà été rédigés par le passé, en ne traitant que d’un domaine de l’ophtalmologie pédiatrique tel que les cataractes congénitales (Pr Jules François, 1959), les cécités de l’enfance (Pr Martine Fontaine, 1969), les aberrations chromosomiques en ophtalmologie (Pr Jules François, 1972), les nystagmus (Pr Denise Goddé-Joly, 1973), la génétique en ophtalmologie (Pr Jean-Louis Dufier, Dr Josseline Kaplan, 2005), aucun Rapport dédié à l’ophtalmologie pédiatrique dans sa globalité n’a été proposé. C’est sous l’impulsion du Pr Gilles Renard qu’est né le projet de ce nouveau et premier Rapport de la Société Française d’Ophtalmologie sur l’Ophtalmologie pédiatrique, projet soutenu par le conseil d’administration d’alors avec en particulier son président, le Pr Philippe Denis, et son secrétaire général, le Pr Christophe Baudouin.
Qu’est ce que l’ophtalmologie pédiatrique ? Nous pouvons dire aujourd’hui que cette sur-spécialité prend en charge le système visuel de l’enfant de la conception jusqu’à la fin de l’adolescence avec pour cible les amblyopies fonctionnelle et organique et leurs facteurs de risque.
Cela implique :
une surveillance du développement physiologique, grâce à des examens systématiques, surtout pendant les deux premières années (période critique du développement visuel) mais aussi au-delà ;
un dépistage, une détection, un diagnostic et une thérapeutique spécifiques et précoces des atteintes oculaires qui peuvent retentir sur la maturation visuelle et générer des cécités, qui sont évitables dans plus de 80 % des cas ;
un accompagnement très précoce du handicap visuel à moduler en fonction de l’âge.
Cela implique également de souligner les progrès remarquables réalisés depuis deux décennies dans le dépistage, le diagnostic et le traitement des pathologies et la déficience visuelle ; on citera pour exemples les résultats fonctionnels obtenus dans les cataractes congénitales, dans le glaucome congénital primitif, dans le rétinoblastome, dans les craniosténoses et plus récemment dans la rétinopathie des prématurés.
Le sujet étant très vaste, les auteurs ont suivi deux principes :
le premier, d’élaborer un plan en concertation avec des experts hospitaliers et libéraux ; le Rapport s’articule ainsi autour des chapitres suivants : règles générales et spécifiques de la prise en charge ; examen de l’enfant ; arbres décisionnels ; questions courantes ; principales pathologies (plus de 20 chapitres) ; interdisciplinarité ; aspects fondamentaux ; dépistages ; handicap visuel ;
le second, de ne pas aborder la strabologie de l’enfant (traitée dans le Rapport 2013 Strabisme du Pr Alain Péchereau).
Notre souhait, à travers ce rapport, est de conforter les ophtalmologistes dans leur rôle de dépistage, de prise en charge, d’accompagnement et de suivi de l’enfant, un « être en devenir » , afin de lui assurer la meilleure fonction visuelle possible pour la meilleure qualité de vie.
La rédaction de ce Rapport nous aura permis de dresser un bilan de notre sur-spécialité et de cibler les progrès qui restent à faire en épidémiologie, dans le dépistage et la prise en charge des pathologies et pour le développement des instituts spécialisés.
Nous sommes reconnaissants à la Société Française d’Ophtalmologie et à son conseil d’administration de nous avoir fait l’honneur de nous confier ce travail.
J’adresse mes remerciements à Alain Péchereau qui, un jour de mars, a su vaincre mes hésitations et me convaincre de coordonner ce Rapport ; c’était il y a 4 ans !
Nous sommes très honorés que David Taylor ait accepté de préfacer ce livre car il est depuis longtemps notre principale référence.
Nous remercions tous les auteurs, amis ou collègues professionnels qui ont participé à la rédaction ou oeuvré au difficile et délicat travail de relecture : désormais cet ouvrage existe, il constitue une mise au point de nos connaissances actuelles à un moment précis dans l’histoire de l’ophtalmologie, mais surtout représente sur le plan émotionnel une merveilleuse expérience riche de relations humaines ineffables.
Nous aurons en priorité une pensée reconnaissante pour notre confrère Emmanuel Bui Quoc qui a été durant ces longs mois de rédaction d’une présence et d’une aide indéfectibles. Nous gardons également une pensée pleine d’affection pour l’équipe marseillaise d’ophtalmologie avec Fréderic Matonti et Louis Hoffart auxquels nous associons Monique Marongiu ; sans oublier Pierre Wary, Aurore Aziz-Alessi, Émilie Zanin, Sophie Bertrand, Marie Beylerian, Marie Callet, Carole Burillon, Saad Ouadahi, Isabelle Rendu, qui m’ont accompagnée au quotidien. Nous remercions toute notre équipe de l’Hôpital Nord, médicale, soignante, administrative, en formation avec tous nos internes. Merci à cette extraordinaire équipe solide, joyeuse, travailleuse, respectueuse, disponible depuis 4 ans et qui a contribué directement ou indirectement à cette lourde tâche. Merci aussi à tous ceux qui m’ont aidée, chacun à leur manière, à parcourir ce chemin souvent difficile : Bahram Bodaghi, Jean-Paul Segade, Claude Bertrand, Fréderic Collet, Nathalie Azar, Françoise Lavenant, Gilles Chaine, Jean-Michel Viton, Georges Leonetti et Dominique Rossi.
Nous remercions chaleureusement tous les collègues français ophtalmopédiatres qui m’ont apporté leur disponibilité, leur compétence, leur aide précieuse et leur amitié tout au long de la construction de ce livre ; je ne les cite pas car ils se reconnaîtront.
Nous remercions également toute l’équipe des pédiatres spécialisés de l’hôpital de la Timone et de l’hôpital Nord pour les échanges très enrichissants que nous avons eu ensemble ; eux aussi se reconnaîtront.
Nous voulons rendre hommage à notre éditeur Elsevier qui, depuis plus d’un siècle et demi, est une référence en termes de publications scientifiques et remercier dans son équipe l’ensemble des collaborateurs ayant participé à l’élaboration de ce livre.
Enfin, je dédie ce Rapport 2017 du 123e congrès de la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) à Gilles Renard, directeur administratif et scientifique de la SFO car c’est à lui qu’en revient l’initiative et le risque ! Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude pour sa confiance, ses avis et conseils éclairés, sa bienveillance à mon égard et plus largement de m’avoir guidée et accompagnée dans ce travail. Je remercie aussi Francis Phung, Suehanna Nagi et Yvan Caudard, les permanents de la SFO, pour leur disponibilité permanente et chaleureuse. Je remercie également Jean-Antoine Bernard.
Pour terminer, j’ai une pensée toute particulière pour mes parents, ma famille et mes amis proches, présents ou malheureusement partis pendant la rédaction de ce Rapport et pour toi, ma fille Pauline-Marion pour ton soutien indéfectible. Que ce travail t’aide à trouver l’énergie et la perspicacité dont tu auras besoin dans tes études actuelles et futures.
Bonne lecture à toutes et tous.
Danièle Denis
Lorsque j’ai commencé mes études d’ophtalmologie, l’idée de devoir m’occuper d’enfants m’était étrangère. Grâce à la strabologie qui m’a tout de suite fasciné par son côté spéculatif, je me suis intéressé à l’ophtalmopédiatrie au point d’en faire, avec la strabologie, mon activité exclusive à la fin de ma carrière.
Quarante et un ans plus tard, lors de la cérémonie de mon départ en retraite, je terminais mon allocution par des remerciements pour des absents : les patients que j’avais pris en charge pendant ces 41 années. Beaucoup m’avaient apporté leurs problèmes, les avaient mis sur la table en toute simplicité. Nous avions, ensemble, essayé de construire un projet thérapeutique parfois long et difficile, parfois décevant, souvent encourageant. Ces patients m’ont progressivement transformé. Ils m’ont donné beaucoup plus que je leur ai donné. Parmi ceux-ci, un groupe se détache : ce sont les enfants et tout particulièrement les jeunes enfants. Ils ont changé radicalement ma façon de les voir et mon rapport avec eux. Ils ont été, pour moi, une leçon de vie, une leçon d’humanité.
Celui-ci a été pour moi un objet d’étonnement. Certes l’oeil suit tout un processus de maturation fort complexe (dans ce domaine, il reste à écrire l’influence d’une expérience visuelle de mauvaise qualité sur le développement de l’oeil) et qui mettra quelques années à parvenir à maturité. Mais c’est le développement du cerveau qui m’a laissé le plus admiratif. Quatre éléments l’ont été particulièrement pour moi.
La vulnérabilité du système visuel à une expérience de mauvaise qualité m’a beaucoup surpris. Les étudiants en médecine sont stupéfaits lorsque je les informe que l’on peut rendre malvoyant un nouveau-né avec une occlusion totale et prolongée de plusieurs années (c’est ce qui arrive avec les cataractes congénitales bilatérales complètes non prises en charge, j’en ai connues). Cette vulnérabilité touche la totalité des voies visuelles et le cortex visuel. C’est grâce à ces connaissances que le traitement de toutes les formes d’amblyopie fonctionnelle a progressé de façon radicale.
Naturellement, ce qui est vrai pour le système visuel l’est aussi pour tous les autres sens (les implants cochléaires l’ont bien démontré) et pour l’ensemble des fonctions cérébrales. L’expérience commence dès la naissance (elle est probablement anténatale) et touche tous les domaines de l’activité cérébrale. C’est pourquoi, et ceci dès la naissance, la qualité du signal visuel partant de la rétine devrait être une obsession pour tous les ophtalmologistes.
Si la génétique a un rôle important, l’expérience a un rôle tout aussi important (le débat inné/acquis n’a aucun sens, ce sont les deux faces d’une même pièce). Nous, les adultes, devons veiller à ce que le cerveau immature se développe suivant toutes ses potentialités. Notre empreinte doit être la plus discrète possible.
Plus le temps a passé, plus sa compréhension m’a rendu admiratif sur cette fonction. Comment le cerveau arrive-t-il à partir de deux images simples et planes mais légèrement différentes à construire un monde en trois dimensions en parfaite concordance avec le réel ? On ne peut qu’être admiratif devant l’exactitude de ce travail fait en temps réel.
Dans les années 1970, j’avais été fasciné par les livres d’Henri Laborit [1] et par sa description de la théorie du cerveau triunique de Paul MacLean (théorie abandonnée depuis) [2]. Je ne savais pas que d’une certaine façon cette problématique rejoindrait celle du strabisme. En effet, la façon dont le cerveau résout les problèmes qu’il rencontre est remarquable. Deux exemples pour illustrer ce propos.
Dans les neurones de la lecture, Dehaene [3] montre que la lecture s’est développée en utilisant des aires cérébrales utilisées précédemment à la reconnaissance des formes et des objets. Les neurones de ces aires ont été « recyclés » . Dans un temps extrêmement court (à l’échelle du temps de l’espèce humaine, la lecture est un phénomène extrêmement récent), le cerveau a su s’adapter.
Le cerveau visuel du sujet normal présente un certain nombre de déséquilibres [4–6] liés à son évolution phylogénétique qui devrait apparaître « normalement » : le nystagmus latent et la déviation verticale dissociée. Pour résoudre ce problème, une couche supérieure de traitement a été mise en place : la vision cyclopéenne (la vision binoculaire normale). En d’autres termes, la vision cyclopéenne permet d’équilibrer un système visuel structurellement déséquilibré. Elle se comporte comme un programme informatique mis en place pour corriger les erreurs du logiciel système. Fascinant !
L’enfant naît hypermétrope. Statistiquement, il le restera plus ou moins. L’hypermétropie est l’amétropie qui est la mieux compensée par le système visuel de l’enfant. Cette compensation permet d’obtenir une bonne acuité visuelle de loin pendant un temps court, ce que ne permet pas l’astigmatisme ou la myopie. Elle est régulièrement sous-estimée par les réfractomètres modernes.
Cette compensation, comme toutes les compensations (cela est bien un message fort de l’ophtalmopédiatrie), a un prix :
sur l’acuité visuelle : l’hypermétrope s’habitue à voir flou. Il n’est pas nécessaire de voir net pour bien vivre. Ce flou va avoir deux conséquences : une mauvaise acuité visuelle (voir les chapitres sur la réfraction de cet ouvrage) et une dérégulation oculomotrice (voir plus loin) ;
sur l’oculomotricité : du fait du flou et d’un fonctionnement anormal de l’accommodation, les mécanismes de régulation de l’oculomotricité seront déréglés en permanence ;
sur les signes fonctionnels : les deux désordres précédents vont s’accompagner d’une symptomatologie fonctionnelle bien connue.
Tous ces troubles vont avoir des conséquences importantes dans le temps long. La correction exacte du trouble amétropique à ce moment-là ne résoudra pas ces problèmes qui auront eu le temps de s’ancrer de façon définitive.
La prise en charge ophtalmopédiatrique montre que nous, les professionnels, sommes redevables de la performance visuelle et du confort futur de nos jeunes patients. Ils dépendent de la qualité de notre prise en charge.
Prendre en charge un enfant, c’est prendre conscience de la notion du temps, de ce temps qui court et qui nous file entre les doigts. La prise en charge ophtalmopédiatrique nécessite la durée, le temps long. Ceci est contradictoire avec notre époque qui adore le temps court, le résultat immédiat, la satisfaction pour solde de tout compte.
L’ophtalmopédiatre comme le strabologue, s’il est évalué dans l’immédiat, l’est surtout sur le temps long. Cet enfant que je prends en charge, grâce à la vue obtenue, rentrera-t-il dans un CP « normal » ? Suivra-t-il dans un cycle « normal » ? Quelle voie professionnelle suivra-t-il ? Comment abordera-t-il le moment de la presbytie qui est souvent le juge de paix des choix antérieurs ?
Ce temps long et ses incertitudes font que l’on doit se battre de façon acharnée pour obtenir le moindre gain et pour éviter la moindre perte. À quelques mois ou années de vie, quel thérapeute peut dire qu’il connaît quel sera le bon oeil dans les pathologies ophtalmopédiatriques évolutives ? Il faut se battre sur tous les fronts et avec acharnement pour que chaque oeil soit mené à son maximum de performances visuelles et qu’il les conserve pour la plus longue durée possible (toute une vie !). Toute autre attitude est une attitude de mépris envers ceux que nous prétendons soigner. Ce combat fait toute la grandeur de l’ophtalmopédiatrie.
La durée de vie professionnelle moyenne d’un ophtalmologiste installé est de l’ordre d’une trentaine d’années. Ce qui fait que chaque enfant pris en charge a une durée de surveillance par le même médecin de l’ordre d’une quinzaine d’années. En moyenne, chaque enfant sera suivi par trois ophtalmologistes jusqu’à l’âge de la presbytie et trois autres jusqu’à la fin de la vie. Chaque ophtalmopédiatre doit transmettre au suivant un patient dont les performances visuelles auront été parfaitement optimisées et dont les choix thérapeutiques auront été pesés à l’aune du temps.
Les parents représentent la diversité heureuse (d’aucuns diraient malheureuse, mais je maintiens le terme) de notre société. On voit de tout et nous le savons tous. Mais il y a une constance : avoir un enfant et a fortiori un nouveau-né ou un nour- risson atteint d’une maladie grave est un traumatisme d’une rare violence qui va bien au-delà de la rupture narcissique de « l’enfant parfait » . Les parents sortent déroutés, « perdus » par l’annonce qui vient de leur être faite. Ils sont étonnés au sens étymologique du terme ( « ébranler à la manière du tonnerre » [7]). Leur surprise est telle que, même s’ils s’y étaient préparés, ils subissent une véritable sidération qui empêche que les informations données soient comprises. Ils ont besoin d’un temps d’incubation. Là, on peut regretter l’absence de groupes de parole qui permettraient aux « anciens » de faire partager leur expérience aux « nouveaux » . La faible incidence des troubles ophtalmopédiatriques lourds rend ce projet très aléatoire.
Après ce moment difficile, ils s’attaquent à ce problème avec courage et espoir. Mais il faut le reconnaître, ce n’est souvent que le début d’une « longue marche » dans laquelle certains se perdent pour de multiples raisons : financière (malgré les prises en charge, un enfant malade coûte cher voire très cher), familiale (famille nucléaire : un oeil contre un divorce ; famille étendue : importance des soutiens familiaux), personnelle, de distance (tout kilomètre augmente la difficulté de la prise en charge). Nul ne peut les juger et, ici, rendons leur hommage.
J’aurai une pensée toute particulière pour les mamans. Leur capacité d’abnégation, de persévérance et de courage a toujours été pour moi une source d’admiration. Après avoir pleuré dans le cabinet de consultation devant un résultat insatisfaisant malgré un effort déjà considérable et les mots peu amènes du thérapeute pour montrer la gravité de la situation, elles repartent comme un soldat de la guerre 14-18 devant la mitraille. Une phrase résume leur attitude : « c’est mon bébé » , soit en d’autres termes c’est « la chair de ma chair » [8].
Il est temps de parler d’eux. Naturellement l’expérience est très diverse. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a un environnement propre dont il est plus souvent la victime que l’acteur. On peut souligner quelques traits communs : sa gentillesse, sa franchise, son refus du mensonge et de la déloyauté, son courage (qu’il est grand son courage !), et son admiration pour son thérapeute. Tout cela peut se résumer par le mot : confiance.
Comment acquérir la confiance d’un enfant ? Il faut le traiter en personne responsable (ne pas l’infantiliser). Lui, comme ses parents, a le droit d’avoir des explications qu’il comprend. Il ne faut jamais lui mentir (je n’ai pas dit qu’il faut lui dire toute la vérité). Ce point est particulièrement important. Il faut lui faire comprendre que jamais le thérapeute ne lui mentira. Il doit pouvoir s’abandonner dans la parole du thérapeute. Si cela doit faire mal, il faut lui dire avec exactitude. Tout ce qui va arriver doit être dit. Ainsi s’instaure une relation qui permet de mener à bien le projet thérapeutique. Celle-ci permet d’aborder dans une relation forte les tempêtes de l’adolescence où, pour certains enfants, un de ses rares points fixes et bienveillants est le thérapeute (on se demande ce qu’ont fait certains enfants pour mériter la vie que les adultes leur font subir…). Cela permet d’établir ce lien qui les fait revenir au « nid » quand les aléas de la vie les auront dispersés et qu’ils se posent des questions sur leur avenir visuel ou celui de leur enfant. Que de souvenirs !
Dans notre pays, on ne peut que constater que la prise en charge ophtalmologique des enfants reste encore déficiente. La future réforme du DES d’ophtalmologie en individualisant et en exigeant une formation supplémentaire aux ophtalmologistes s’intéressant aux pathologies de l’enfant est une très bonne évolution qu’il faut saluer et qui devrait permettre un progrès dans la prise en charge de tous les troubles ophtalmopédiatriques.
[1] Laborit H. https: //fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Laborit.
[2] MacLean P. https: //fr.wikipedia.org/wiki/Paul_D._MacLean
[3] Dehaene S. Les neurones de la lecture. Paris : Odile Jacob ; 2007. p. 478.
[4] Bui Quoc E, Milleret C. Origins of strabismus and loss of binocular vision. Front Integr Neurosci 2014 ; 8 : 71.
[5] Brodsky MC. An expanded view of infantile esotropia : bottoms up ! Arch Ophthalmol 2012 ; 130(9) : 1199‑202.
[6] Tychsen L. Infantile esotropia : current neurophysiologic concepts. In : Rosenbaum AL, Santiago AP. Clinical strabismus management. Philadelphia : W.B. Saunders Company ; 1999. p. 117-38.
[7] Étonner. https: //fr.wiktionary.org/wiki/étonner.
[8] Genèse, 2: 23.
Alain Péchereau
LesLes compléments en ligne peuvent être consultés aux adresses :
http://www.em-consulte.com/e-complement/475022
Préface – version originale
Chapitre 3
eEncadré 3-1
Utilisation des collyres mydriatiques en pédiatrie pour l’obtention d’une mydriase ou d’une cycloplégie à visée diagnostique : recommandations 2012 ANSM.
eEncadré 3-2
Utilisation des collyres mydriatiques en pédiatrie pour la dilatation pupillaire : prématurés, nouveau-nés, enfants. Fiche d’information SFO.
Chapitre 4
eFig. 4-1
Mon enfant a une baisse de l’acuité visuelle.
eFig. 4-2
Mon enfant est gêné par la lumière.
eFig. 4-3
Mon enfant a la tête penchée.
eFig. 4-4
Mon enfant cligne des paupières.
eFig. 4-5
Mon enfant a une lésion de la paupière.
eFig. 4-6
Mon enfant a une paupière basse.
eFig. 4-7
Mon enfant a l’oeil qui coule – CAT devant un larmoiement.
eFig. 4-8
Mon enfant a l’oeil rouge.
eFig. 4-9
Mon enfant a un oeil trop gros ou trop petit.
eFig. 4-10
Mon enfant a une tache à l’oeil.
eFig. 4-11
Mon enfant a mal à la tête.
eFig. 4-12
Mon enfant est né prématuré.
eFig. 4-13
Dans la famille…
eFig. 4-14
Mon enfant a une dyschromatopsie.
eFig. 4-15
Mon enfant a une exophtalmie.
eFig. 4-16
Mon enfant a des anomalies de la transparence de l’oeil.
eFig. 4-17
Mon enfant a une leucocorie.
eFig. 4-18
Mon enfant a une pathologie de surface.
eFig. 4-19
Mon enfant a des pupilles de taille différente.
eFig. 4-20
Mon enfant a une lésion rétinienne.
eFig. 4-21
Mon enfant a une atrophie optique.
eFig. 4-22
Mon enfant a une papille floue.
eFig. 4-23
Mon enfant est tombé d’une faible hauteur : accident ou maltraitance.
eFig. 4-24
Mon enfant à la yeux qui tremblent.
eFig. 4-25
Mon enfant louche.
eFig. 4-26
Mon enfant voit double.
eFig. 4-27
Mon enfant a une uvéite.
Chapitre 5
Vidéo 5-1
Potentiels évoqués visuels par renversement de damiers.
Vidéo 5-2
Potentiels évoqués visuels ON-OFF.
Vidéo 5-3
Potentiels évoqués visuels par balayage. Stimulus.
Chapitre 7
eFig. 7-1
Les différents types d’épicanthus.
eFig. 7-2
Cure de l’épicanthus et du télécanthus par double plastie en Z de Mustardé (a) et plastie Y-V (b).
eFig. 7-3
Canthopexie transnasale.
eFig. 7-4
Raccourcissement du releveur par voie antérieure.
eFig. 7-5
Raccourcissement du releveur par voie conjonctivale.
eFig. 7-6
Technique par résection cutanée semi-lunaire.
eFig. 7-7
Rétraction du bord libre palpébral post-traumatique, traitée par greffe de peau sus-claviculaire chez un enfant de 12 ans.
eFig. 7-8
Suture bord à bord avec canthotomie, cantholyse de décharge.
eFig. 7-9
Lambeau d’avancement par canthotomie, cantholyse.
eFig. 7-10
Coupe transversale de paupière inférieure distinguant lamelle antérieure et lamelle postérieure.
eFig. 7-11
Différents sites de prélèvement de greffe cutanée.
eFig. 7-12
Molluscum contagiosum du bord libre supérieur et conjonctivite folliculaire.
eFig. 7-13
Chalazion kystique de la paupière supérieure.
eFig. 7-14
Kyste de Zeiss.
eFig. 7-15
Hémangiome capillaire infantile entraînant un ptosis et amputant l’axe visuel.
eFig. 7-16
Malformation artérioveineuse palpébrale caractérisée par un réseau veineux dilaté et une pigmentation bleuâtre.
eFig. 7-17
Névrome plexiforme de la paupière supérieure comblant le creux sustarsal et ptosant.
eFig. 7-18
Kyste dermoïde de la queue du sourcil.
Chapitre 13
5. Rééducation de la cataracte congénitale
Chapitre 22
Vidéo 22-1
Absence de suivi oculaire chez un nourrisson secondaire à un retard de maturation.
Vidéo 22-2
Apraxie oculomotrice chez une enfant de 18 mois.
Vidéo 22-3
Errance du regard chez un nourrisson de 5 mois atteint de dystrophie rétinienne précoce.
Chapitre 27
Vidéo 27-1
Anesthésie pédiatrique avec induction en hypnose par utilisation de métaphores.
Vidéo 27-2
Anesthésie pédiatrique avec induction en hypnose dite dirigée.
Vidéo 27-3
Arrivée d’un enfant au bloc opératoire, après induction en hypnose, sans prémédication préalable.
Chapitre 28
eFig. 28-1
Transmission autosomique dominante.
eFig. 28-2
Transmission autosomique récessive.
eFig. 28-3
Transmissions liées à l’X.
eFig. 28-4
Transmission mitochondriale et pathologies mitochondriales.
Chapitre 32
eFig. 32-1
Certificat médical.